La pollution générée par l'essor des IA

Une technologie gourmande à toutes les étapes
Avant l’usage : une infrastructure vorace
Avant même leur allumage, les IA ont déjà une dette assez lourde. En effet, la fabrication des serveurs, des puces et autres composants électroniques nécessaires à leur bon fonctionnement nécessite des terres rares, dont l’extraction et le raffinage sont des opérations à la fois énergivores et polluantes. En plus de mobiliser des ressources naturelles limitées, cela provoque des dégâts environnementaux dans des régions souvent déjà fragiles (Birmanie, République Démocratique du Congo…). Enfin, en prévision du fonctionnement de ces IA, il faut mailler les réseaux planétaires avec un nombre croissant de centres de données (data centers), qu’il faut, perpétuellement et abondamment, refroidir et alimenter… La construction d’un seul de ces centres peut nécessiter des milliers de tonnes de béton et d’acier, et a des répercussions foncières : artificialisation des sols, aménagement des réseaux…
Pendant l’usage : une machine à consommer
Une fois la mise en service d’une IA, et avant de la rendre opérationnelle et accessible au public, il faut l’entraîner. En clair, lui faire ingurgiter des milliards de pages web, de fichiers pdf, de livres, et d’enregistrements de toutes sortes. Cette “simple” étape libère déjà des centaines de tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Une fois prête, une intelligence artificielle générative pourra répondre aux questions des internautes, en consommant massivement eau et électricité à chaque requête.
Exemples chiffrés :
- L'entraînement de GPT-3 a consommé 626 000 kg de CO₂, soit l’équivalent de 72 fois le tour du monde en voiture.
- Une simple requête posée à ChatGPT nécessite 30 fois plus d’énergie qu’une recherche Google classique.
- Générer une image IA HD consomme jusqu’à 11 Wh, soit la moitié d’une recharge de smartphone.
- 25 questions posées à ChatGPT = ½ litre d’eau douce, selon l’Université du Colorado.
Face à des utilisations de plus en plus nombreuses (plus de 200 millions d’utilisateurs par mois pour ChatGPT, pour ne citer qu’eux), l’impact est démultiplié !
Après usage : déchets électroniques et obsolescence programmée
Cette course à la performance accélère également le renouvellement du matériel : nouveaux serveurs pour les data centers, multiplication des cartes graphiques, solutions intensives de refroidissement. On se retrouve ainsi face à une explosion de la quantité de déchets électroniques, rarement recyclables, donc souvent exportés, ce qui est encore rarement bien pris en compte dans les bilans écologiques de l’IA.
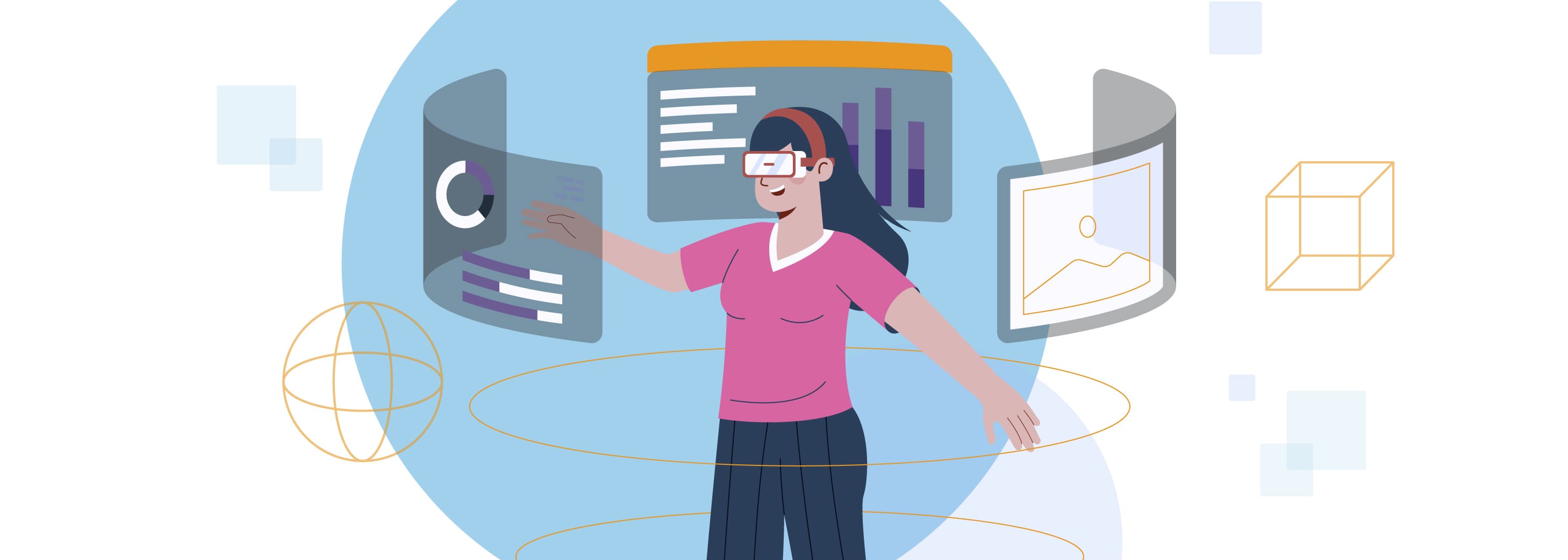
Ce que nous disent les chiffres (et ce qu’on ignore encore)
En ce qui concerne l’intelligence artificielle, les chiffres, quoique très élevés, restent assez imprécis. On estime plus que l’on ne mesure, car le secteur, encore récent, est souvent opaque.
Une consommation d’énergie exponentielle
En 2022, toutes les IA rassemblées ont utilisé près de 460 TWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle de la Suède ou de l’Argentine. Et Deloitte France estime que cette consommation pourrait avoisiner les 1 000 TWh dès 2030, avec un risque d’atteindre 3 500 TWh à l’horizon 2050. Pour l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la consommation électrique des IA sera multipliée par 10 d’ici 2026. Pour terminer avec une autre comparaison, revenons sur les data centers (plus de 8 millions dans le monde à ce jour) : en 2024, leur consommation moyenne équivalait à l'électricité nécessaire pour alimenter une ville de 30 000 habitants !
Une soif qui dépasse l’entendement
Ici on va parler d’eau ! Et on commence avec les 700 000 litres utilisés pour refroidir GPT-3 durant son seul entraînement. On continue avec 5 litres nécessaires à la génération de chaque image (jusqu'à 12 litres pour un seul starter pack, par exemple). Enfin, la consommation d’un datacenter peut atteindre 190 millions de litres par an (hors épisode de canicule, durant lesquels les systèmes de refroidissement doivent tourner encore plus fort). Dans le contexte global de tensions hydriques, on se demande bien comment on va continuer de trouver les milliards de litres d’eau douce utilisés par les IA chaque année…
Une empreinte carbone hors de contrôle
Si on extrapole les données disponibles existantes, l’intelligence artificielle, les data centers et la cryptomonnaie devraient générer environ 37 milliards de tonnes de CO2 d’ici 2026. Pour s’en tenir à la France, le secteur digital (incluant l’IA) pourrait représenter 50 millions de tonnes de CO2 en 2050, soit trois fois plus qu’en 2024. Enfin, rappelons que les émissions de Google ont augmenté de 48% sur les 5 dernières années, principalement à cause des ajouts successifs de couches d’IA sur son moteur.
Et pourtant… personne ne sait vraiment… L’Université de Stanford a publié des recherches témoignant de l’impossibilité d’évaluer précisément l’empreinte écologique des IA génératives, à cause de l’absence actuelle de normes juridiques contraignant les acteurs du domaine à publier leurs chiffres. Faute de données fiables, on en est parfois réduit aux suppositions et à la méthode du doigt mouillé… De leur côté, les entreprises comme OpenAI et consorts s’appuient sur le secret industriel pour dissimuler la consommation effective de leurs serveurs et modèles. On attend impatiemment une régulation performante pour dissiper cette opacité.

L’IA peut-elle devenir durable ?
D’emblée, cette question semble paradoxale : comment une technologie aussi lourde, centralisée et dépendante de ressources critiques pourrait-elle s'accommoder des limites terrestres ? Certains semblent y croire, et commencent à s’organiser : ils se regroupent pour produire des référentiels, des cahiers des charges, et structurer des bonnes pratiques. Examinons certaines de ces initiatives.
L’IA frugale : un concept, pas encore une norme
En février 2025 s’est tenu un sommet mondial sur l’IA, et la France y a défendu son projet de coalition pour une IA écologiquement durable, en partenariat avec le PNUE et l’UIT. Le projet ? Concevoir une IA plus sobre dès sa conception. Un référentiel développé par l’Afnor et le ministère de la Transition écologique vise à encourager l’écoconception logicielle (code allégé), la gestion raisonnée des données (des entraînements plus modestes), et une modélisation allégée (des modèles d’IA plus petits et spécialisés). Il reste maintenant à faire adopter ces normes par une majorité de pays, ce qui s’annonce pour le moins compliqué.
Quatre leviers concrets pour une IA plus responsable
Pour contenir l’impact négatif des IA, quatre axes ont été identifiés par Deloitte France :
- efficacité énergétique accrue : améliorer les composants, généraliser le refroidissement liquide, mutualiser les data centers ;
- recours massif aux énergies renouvelables : alimenter les IA avec des énergies fossiles est impensable aujourd’hui
- transparence des indicateurs : harmoniser les standards des métriques, publier la consommation réelle des modèles
- intégration territoriale des infrastructures : favoriser les synergies locales (réutilisation de chaleur, consommation intelligente) et un ancrage industriel responsable.
Des limites évidentes
Même en améliorant la conception de ces outils, aucun scénario vertueux ne se produira si les utilisateurs n’en font pas un usage plus raisonné. Générer une batterie d’images pour un post sur les réseaux sociaux, ou créer 100 logos en quelques secondes, ce n’est pas un progrès, mais un abus. Il ne faut pas négliger non plus l’effet rebond : plus les IA sont puissantes, plus elles sont utilisées, et plus leur empreinte augmente. L’avenir de l’IA repose ainsi moins sur sa puissance que sur le discernement de ses utilisateurs.

Graphitéine : refuser l’automatisme pour défendre l’humain
Devant tant d’inconnu et de risques potentiels, Graphitéine a pris une décision claire : celle de la création 100% humaine. Nous nourrissons depuis des années des valeurs de proximité avec le souci d’une communication responsable, pour nous comme pour nos clients, et cela nous semblerait incohérent de sacrifier autant de ressources sur l’autel de la productivité.
Ce que nous refusons
Chez Graphitéine, nous ne générons plus rien avec l’IA : ni texte, ni visuel. Nous n’utilisons pas de générateurs d’images, pas d’outil de réécriture automatique, pas de prompt, parce que la manière nous importe autant que le résultat. D’autant plus qu’aucun algorithme ne remplacera jamais une vraie compréhension de votre personnalité, de votre produit, et de votre contexte.
Nous ne déléguons pas la création à des machines entraînées sur des données plus ou moins volées à d’autres créatifs. Nous ne publions pas en masse. Nous préférons rencontrer, écouter, explorer, proposer, corriger.
Une décision aussi éthique qu’écologique
Refuser la génération automatique, c’est aussi lutter contre :
- des images qui coûtent plusieurs litres d’eau douce;
- des usines à gaz pour produire des textes ou images médiocres;
- des serveurs surdimensionnés pour produire ce que la main pourrait dessiner avec plus de justesse, de sens et de nuance.
Nous assumons une forme de lenteur choisie, d’artisanat numérique. C’est notre manière de prendre soin de nous, de nos clients, et de leur public.
Notre boussole : cohérence & impact réel
Créer sans IA ne signifie pas que nous refusons toute technologie. Mais avant d’adopter un outil, nous préférons en interroger les usages, et faire la part des choses entre l’utile et l’effet de mode. Nous avons intégré à nos pratiques des outils numériques mesurés, pertinents, et compatibles avec nos engagements, en privilégiant des solutions locales, open source ou sobres. Nous restons vigilant quant à notre propre impact (hébergement, flux, cycles de production) et nous nous engageons à l’améliorer continuellement.
Cette exigence fait partie de notre ADN. Nous travaillons avec des humains, pas avec des algorithmes.

Conclusion : à nous de choisir les limites
L’IA n’est pas vertueuse, elle n’est pas gratuite, ni pour nous, ni pour nos enfants. Derrière chaque image générée, chaque réponse instantanée, s’élève une infrastructure massive et énergivore. Pour un usage individuel, l’impact semble minime, mais à l’échelle mondiale, il est déjà énorme.
Alors, faut-il bannir l’intelligence artificielle ? Sans doute pourrait-elle être très utile dans certains secteurs (la santé et la médecine, par exemple). Mais pouvons-nous continuer de nous en servir pour multiplier les starter packs à notre effigie sur les réseaux sociaux ? Certainement pas. La vraie question n’est plus de savoir si l’IA pollue, mais pour quels usages il est encore légitime de la mobiliser.
Chez Graphitéine, nous avons fait un choix simple : ne pas automatiser ce qui doit rester profondément humain. Créer, communiquer, échanger, voilà ce qui nous fait nous lever avec plaisir le matin. Pourquoi contrarier notre épanouissement en délégant tout cela à des machines, aussi perfectionnées soient-elles ?
💬 Envie d’une communication qui respecte vos idées autant que la planète ?
Discutons-en autour d’un thé.






